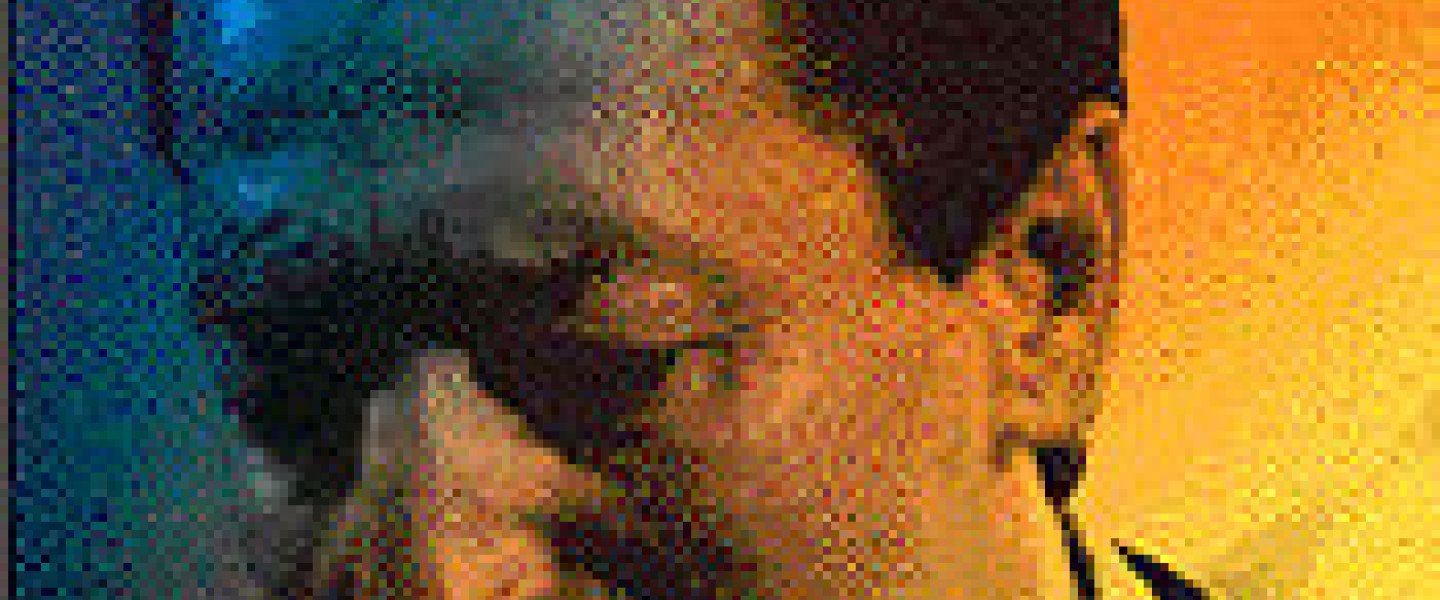
Né le 30 août 1959 à Paris et aîné d’une famille de cinq enfants, Karim Kacel a été révélé, en 1982, lors d’une audition organisée par la major Pathé- Marconi et filmée par l’excellente émission « Moi, je ». Soumise au vote, sa chanson-ode acoustique banlieue, qui, bien avant l’explosion du rap, évoquait les cités et leurs aléas, sera, à la demande des téléspectateurs, diffusée deux fois. Le tout dans un contexte très agité socialement (grèves, marche des beurs…), politiquement (montée de l’extrême - droite) et économiquement (crises industrielles). Son premier 45t (1983, chez EMI), comprenant également le titre La chanson du Kabyle, connaîtra un succès immédiat mais, sans doute trop en avance sur son époque, il aura, par la suite, du mal à s’imposer auprès du grand public. En effet, bien que se réclamant de la tradition la plus classique de la chanson française, celle des Brel, Reggiani, Brassens, Moustaki, son ami, ou Mouloudji, de la même origine que lui et dont il reprend Comme un p’tit coquelicot, il est étiqueté « chanteur beur ». Dans ces années 1980, marquées par des crimes racistes et le « sensationnalisme » de quelques médias complaisants, qui repassaient en boucle des images de rodéos et de voitures flambées dans les banlieues, il n’était pas aisé pour un enfant de l’immigration de se faire admettre dans un cercle autre que celui du bâtiment, de la construction automobile ou du…fraisage.
Cependant, Karim, qui a grandi au Kremlin- Bicêtre, a appris la guitare tout seul et a travaillé comme éducateur, persiste et signe de nouveaux disques. Ancien boxeur, il sait encaisser les coups les plus rudes mais aussi en donner à travers des mots résonant comme des directs au cœur et des mélodies au caractère très accrocheur, où fraternisent jazz, swing et blues. Et puis, il y a cette voix : puissante, maîtrisée, tour à tour bouleversante et intense. En 1984, il est remarqué sur diverses scènes, dont un passage mémorable au Théâtre de la Ville et au Printemps de Bourges. Deux ans plus tard, son album P’tite sœur lui vaut les honneurs de l’Académie Charles-Cros et du prix Georges Brassens, décerné par le festival de Sète. S’il n’a pas gagné en notoriété, il a la satisfaction de la reconnaissance de ses pairs et de celle d’un auditoire de qualité, qui vient l’acclamer à chacune de ses apparitions. Il enchaîne les enregistrements et les tournées, chante pour le Pape en Belgique et récolte de nouvelles distinctions prestigieuses comme le Piaf du meilleur spectacle (1988) ou le petit Robert du meilleur parolier, en 1989, lors des Francopholies de Montréal, que lui remettra Léo Ferré en personne. Il est vrai qu’en représentation, Karim n’a pas son pareil pour faire vibrer une salle et lui transmettre des charges d’émotions très fortes. Personnage attachant, il a de multiples facettes attractives, comme le résume joliment Bertrand Dicale, journaliste au « Figaro » : « Si on veut parler de généalogie, Karim Kacel est plutôt blues, tendance Johnny, mélodie, tendance Jonasz, humanisme tendance Le Forestier. Un enfant de chez nous, donc, même s’il aime avoir une derbouka ou un oud – « pour ne pas oublier », aurait dit Ferré ». Rajoutons qu’en 1991, Kacel s’est même investi dans une comédie musicale, à travers une création « T’as beau t’appeler Van Gogh », en collaboration avec le groupe vocal Les Octaves, qu’il jouera à Avignon.
En 2002, sa carrière prend une nouvelle dimension avec l’album Rien que pour toi, où il met en avant (et en valeur) ses racines. La voix est toujours aussi belle, il semble à l’aise dans ses nouveaux habits (orchestraux et mélodiques) orientaux et on se laisse facilement captiver par quelques morceaux comme Tizi-Ouzou. Quand il n’est pas sur les planches, Karim anime des ateliers musicaux « Paroles et Musiques » au sein du comité d’entreprise d’EDF - GDF. Une autre manière de toujours garder la voix au chaud.
R.M.
